II. Birlikte yaşam (Vivre-ensemble) Temalı Yaz Okulu
École d’été en sociologie
Le « Vivre-Ensemble » (2e ed.)

Les 18, 19 et 20 juin 2025 s’est tenue à l’Université Galatasaray la deuxième édition de l’école d’été consacrée au vivre-ensemble. Intitulée « Le vivre-ensemble : crises, résiliences et espaces partagés », cette rencontre a été organisée par le département de sociologie de GSÜ en partenariat avec l’Université de Sofia et le CETOBaC (EHESS), dans le cadre du programme EURETES.
Chaque journée a été rythmée, le matin, par des conférences plénières de grande qualité, et l’après-midi, par les présentations des étudiant.es, qui ont su aborder des thématiques diverses avec rigueur, engagement et originalité.

L’école d’été a débuté par les mots de bienvenue de Cem Özatalay, qui s’est exprimé au nom du comité d’organisation, également composé de Julie Alev Dilmaç et de Velislava Petrova. Dans son intervention, il est revenu sur l’historique du projet VIVENS consacré au vivre-ensemble, en soulignant les partenariats, anciens et récents (CETOBaC-EHESS-EURETES), qui ont contribué à l’élaboration de cet événement scientifique.
L’école d’été s’est articulée autour de trois grands axes thématiques.
La première journée a porté sur les représentations visuelles, discursives et médiatiques susceptibles de fonctionner comme des dispositifs d’invisibilisation et d’exclusion. Elle s’est ouverte par l’intervention de Mme Galia Valtchinova (CETOBaC – EHESS / Université Toulouse II Jean-Jaurès), qui a abordé la problématique du vivre-ensemble à travers le prisme des contacts religieux dans les sociétés balkaniques, du XXe au XXIe siècle.
La seconde conférence plénière a été assurée par Julie Alev Dilmaç (Université de Galatasaray), qui a interrogé la portée symbolique du dessin dans la stigmatisation de l’Autre, à travers une analyse des imaginaires corporels et de la mise en image de l’altérité dans le contexte des relations turco-syriennes.
Les présentations étudiantes de l’après-midi ont prolongé ces réflexions, en explorant différentes modalités d’altérisation : İlknur Köseoğlu a analysé les stratégies de construction de l’altérité dans la presse turque ; Luca Leoni s’est penché sur les métaphores discriminantes dans le discours politique de Giorgia Meloni ; Malika Gueddim a proposé une lecture critique de la représentation de la diversité dans le film “Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?”. Enfin, Kaan Doğanok a livré une réflexion poignante sur l’anonymisation des sépultures, en particulier celles des personnes trans en Turquie.

La deuxième journée a été consacrée aux espaces dits partagés, parfois inclusifs, parfois disputés. La première conférence plénière, prononcée par Athéna Skoulariki (Université de Crète), s’est penchée sur le cas de la ville de Rethymno, à la croisée du tourisme, de la migration et de la coexistence culturelle. Elle y a présenté les dynamiques différenciées d’intégration et de traitement des diverses populations migrantes installées sur l’île. La seconde conférence, assurée par Velislava Petrova, portait sur la construction de l’altérité dans les marchés urbains de Sofia, en tant que principe structurant des interactions sociales.

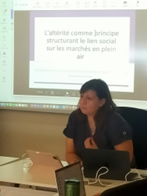
Les présentations étudiantes de l’après-midi ont approfondi les enjeux spatiaux liés à l’inclusion et à l’exclusion. Filyra Vlastou Dimopoulou a ainsi proposé une réflexion sur les camps de réfugiés, tandis que Camilla Salvatore a exploré le mahala comme espace communautaire. Elsa Pınar Kılavuz s’est penchée sur la mémoire urbaine de la communauté juive en Turquie, et Noémie Suissa a interrogé les implications de l’urbanisme défensif en France.
La troisième journée a enfin invité à réfléchir aux formes alternatives de vivre-ensemble, en interrogeant les stratégies individuelles et les engagements collectifs susceptibles de (re)construire des dynamiques d’inclusion. Lors de la conférence plénière, Cem Özatalay (Université Galatasaray) s’est intéressé au rôle des syndicats dans la reconfiguration du lien social et à leur capacité à porter des dynamiques collectives d’intégration.


Cette intervention a été suivie de celle de Camille Leprince, qui a proposé une réflexion sur le vivre-ensemble à l’épreuve des utopies écoféministes kurdes, à travers le film « Who Is Afraid of Ideology? » de Marwa Arsanios. Les participant.es ont ensuite assisté à la présentation de İpek Boldağ et Mücahit Karaca sur les applications de rencontre en Turquie et leur impact sur l’institution familiale. Enfin, Ana Otasevic a offert un éclairage sur l’implication des étudiantes bosniaques de Novi Pazar dans la contestation populaire en Serbie.
Cette dernière journée s’est conclue par une excursion urbaine dans le quartier de Küçük Pazar, guidée par Gizem Kosova, doctorante en sociologie à l’Université Galatasaray. Ce quartier emblématique, marqué par les dynamiques de gentrification et de touristification, a offert aux participant·es de l’école d’été l’occasion de faire le lien entre théorie et pratique, et d’observer concrètement comment le vivre-ensemble peut se construire dans certains espaces d’Istanbul.




